

L'épopée des samourais...
Les films de sabre japonais ont alimenté les
fantasmes et l'imaginaire des nombreux spectateurs japonais, et n'ont jamais
laissé de marbre les spectateurs étrangers.
Plus familièrement baptisé Chambara, contraction des onomatopées
" chan-chan bara-bara "
exprimant le son que fait le sabre qui déchire la chair, les films de genre
regroupés sous le terme de Ken Geki
contiennent des thèmes chers aux japonais, et une lecture à différents degrés
de ces films peut se révéler extrêmement riche en enseignements.
Ces films nous narrent les aventures plus ou moins romancées des Bushi
(terme établi par le shogun Tokugawa
au XVIIe siècle), plus connus en occident sous le terme générique de Samourais.
Le leitmotiv de ces oeuvres est l'illustration du Bushido (la Voie du Guerrier)
et du respect inébranlable des samourais pour celui-ci (il leur était en effet
préférable de le respecter, sinon 'Couic'! (le seppuku,
éventration rituelle pour le non-respect du Code d'honneur, ne devait pas
être une partie de plaisir).
D'autres films rassemblés dans ce genre cinématographique nous narrent diverses
aventures de ronins (les errants) des samourais sans
clans ni maîtres, méprisés par les autres Bushi,
vivant dans la pauvreté et le plus souvent devenus mercenaires. Ils sont souvent
montrés comme des persécutés ou des martyres.
Ce furent ces marginaux, ces parias, ne respectant plus à lettre le code du
samourai qui remportèrent les suffrages du public.
Tous ces hommes étaient les seules personnes de la société japonaise à être
autorisées à porter le sabre, jusqu'à l'ère Meiji
(1868 - 1912).
(D'ailleurs, l'interdiction d'être armé força le peuple à utiliser des instruments
agricoles pour se défendre (serpettes, fléau pour le blé) ou leurs mains nues
(naissance du Karaté d'Okinawa). La nouvelle ère nippone sonna le glas des
bretteurs.
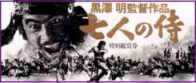
Les 7 samourais
Le passage du
Grand Bouddha:
Roman en trente volumes écrits entre 1913 et 1930 par Nakazato Kaizan. Cette oeuvre littéraire, adaptée à maintes reprises, offrit au genre ses plus beaux fleurons. Nakazato nous narre les déboires de Tsukue Ryunosuke, ronin à tendance belliqueuse sombrant peu à peu dans la folie. A la fin, enragé, il tue innocents et ennemis sans distinction ni état-d'âme. Cette furie meurtrière finira par le conduire à la mort. L'acteur Okochi Denjiro fut le premier à incarner le sabreur psychopathe en 1935 dans un film éponyme du roman. Il faut ensuite attendre l'âge d'or du chambara pour retrouver l'anti-Musashi.

Okochi Denjiro
C'est la guerre...
Bien entendu, en temps de conflit, la censure est
intraitable: les pessimistes et dramatiques ronins disparaissent, ne laissant
le champs libre qu'à d'emblématiques figures.
Les aventures romancées de Musashi Miyamoto
par Yoshikawa Eiji,
parurent dans le quotidien Asahi Shimbun
entre 1935 et 1939.

MifuneToshiro incarne Musashi Miyamoto
Deux volumineux romans rassemblèrent ces écrits:
La Pierre et le Sabre et La parfaite lumière.
Bien entendu, le positivisme de ce personnage haut en couleur ne pouvait
qu'obtenir l'approbation des censeurs.
En 1940,
la première adaptation du roman de Yoshikawa
par Inagaki Hiroshi fut projetée sur les écrans
japonais: Chiezo Kataoka jouait alors le fameux
escrimeur.
Quatre ans plus tard, Mizoguchi Kenji donna sa
version.
Le conflit s'achève...
Les américains contrôlent le cinéma et interdisent les chambaras.
Il faut attendre Kurosawa
pour une renaissance du chambara en 1954: bien que Les
Sept Samourais (chef-d'œuvre absolu, répompé
par John Sturges avec Les 7 mercenaires) soit un film à cheval entre le film
de sabre (Ken-Geki)
et le film d'époque (Jidai-Geki),
il stigmatisme tout de même les principaux éléments inhérents au premier genre.
Dans la même mouvance émergea la meilleure adaptation au cinéma de l'histoire de Musashi: la trilogie réalisée par Inagaki Hiroshi mit en valeur le jeune Mifune Toshiro (La Légende de Musashi (Miyamoto Musashi, 1954) / Duel à Ichijoji (Ichijoji no Ketto) 1954 / La Voie de la Lumière (Ketto Ganryujima) 1955). Le premier film fit impression en occident et obtint en 1954 l'Oscar du meilleur film étranger.
Le cinéma japonais tenait son
Alain Delon: Mifune Toshiro
est le plus célèbre acteur japonais (il faudrait tout de même surveiller de
près la popularité de Kitano Takeshi qui ne cesse de s'accroître.
Ce dernier a d'ailleurs incarné un samourai dans Gohatto
(1999 (sorti en France sous le titre "Tabou" en mai 2000) d'Oshima Nagisa,
film difficilement rattachable aux chambaras mais qui comporte toutefois des
scènes d'escrime magnifiques).
Les années de la maturité...
L'âge d'or du chambara peut donc être déclaré. Le Japon
va connaître la période qui fut la plus fastueuse pour son cinéma, entre 55
et le début des années 70; naturellement, le chambara connut aussi ses oeuvres
majeures.
Kurosawa nous gratifia des chefs-d'oeuvre
que sont La Forteresse Cachée
en 1958 (film transposé (plagié dans ses grandes lignes!) plus tard par Georges
Lucas pour créer la Guerre des Etoiles), Sanjuro
(1961) et Yojimbo
(1962, repompé (encore? C'est une manie!) par Sergio
Leone avec Pour
une poignée de dollars et re-repompé par
Joel Silver avec Last
Man Standing avec Bruce Willis).
Par juste retour d'ascenseur (ou par culpabilité?) Lucas
avec Coppola furent
les producteurs de Kagemusha,
alors que Kurosawa était
dans un sombre période.
On vit ainsi se côtoyer des films relatant les égarements de Tsukue Ryunosuke et les aventures épiques de Musashi.
Le passage du Grand Bouddha
est porté à l'écran en 57 par Uchida Tomu ( Ryunosuke est incarné par Kataoka
Chiezo). En 1960 et 1961, en deux parties, c'est Misumi
Kenji puis Mori Issei
qui offrent la meilleure mouture avec le charismatique Ichikawa
Raizo.
Non moins excellente fut la version d'Okamoto Kihachi
en 1966 avec Nakadai Tetsuya
dont la composition remarquable fait encore froid dans le dos. Entre 1962
et 1965, Uchida Tomu
inscrit sur pellicule une nouvelle version de la vie de Musashi, une nouvelle
trilogie.

Le chambara s'épuise...
Peu à peu, le genre tombe en désuétude, le public préférant
s'extasier devant les récits de Yakusas et un nouvel acteur emblématique de
ces films: Takakura Ken
(le policier japonais de Black Rain).
Mais des réalisateurs talentueux comme Gosha Hideo
produisent encore quelques perles. Ce dernier réalise en 1964 Trois
samourais hors la loi puis Sazen
Tange en 1966.
Son chef-d'oeuvre Goyokin,
est tourné en 1969 avec Nakadai Tetsuya, avec
un duel final dans la neige époustouflant, aussi esthétique que sauvage.
Parallèlement, Kobayashi
Masaki s'attaque au Bushido, en dénonçant la
cupidité des puissants qui utilisent le code du samourais pour parvenir à
assouvir leurs égoïstes désirs de pouvoir et de puissance.
Seppuku (Harakiri)
en 1963 est une oeuvre majeure: Kobayashi,
avec ce tour de force balaye bien des conventions et la fascination aveugle
que l'on peut éprouver envers les samourais et le Bushido. Soyez averti, Kobayashi
vous mènera tranquillement en bateau pour mieux vous déstabiliser!
Il parachève sa filmographie en réalisant Rebellion
en 1967 (avec Mifune Toshiro).
La dernière grande série de films narre les aventures du masseur aveugle Zatoichi,
incarné avec brio avec Katsu Shintaro
(frère de Tomisaburo Wakayama
qui personnifia le dangereux mercenaire Ogami Itto).
Près de 24 films sur Zatoichi
furent produits. Mais rapidement, c'est vers la télé qu'il faudra se tourner
pour assister à de nouveaux épisodes de la saga de Zatoichi.
La seule oeuvre notable durant
les années 70 fut la série des Baby-Cart
(Kozure Ogami).
Six films remarquables, adaptations d'un manga scénarisé par Koike
Kazuo (auteur de Crying
Freeman) et dessiné par Goseki
Kojima.
Ces films réalisés pour partie par Misumi
Kenji ne manqueront pas de surprendre un public
peu habitué aux chambaras.
Mieux vaut réserver ces films à un public (adulte, c'est certain) aguerri
au genre.
Ainsi, on pourra apprécier cette oeuvre à sa juste valeur.
Il faut également noter que la série des Baby-cart fait une belle place aux femmes (surtout dans le deuxième opus avec un clan d'amazones-ninja extrêment farouches), fait suffisamment rare pour être signalé.
Un dernier épisode de Zatoichi fut réalisé en 1989 mais le tournage tourna au désastre. Un grave incident se produisit lors d'une scène de combat: l'acteur Katsu Shintaro ayant utilisé un vrai sabre, un cascadeur fut mortellement blessé. Le chambara est mort, vive le chambara!
Son héritage...
est sans conteste sa présence dans les mémoires
de nombreux spectateurs et réalisateurs: l'influence sur ces derniers est
incontestable (Georges Lucas en première ligne ne cesse de fantasmer sur ce
genre: 'zouip zouip' fait le sabre-laser, 'Uze ze forsseuh Luke' dit Obiwan
Sensei).
Le Ken-Geki
resurgit parfois de façon surprenante: Sergio Leone ne niera pas (il valait
mieux d'ailleurs ne pas nier une telle évidence) que les films de Misumi Kenji
l'ont fortement inspiré pour sa mise en scène et ses si célèbres cadrages
(en effet, il suffit de voir un Baby Cart pour s'en rendre compte).
Plus récemment, c'est dans l'animation japonaise qu'il faut chercher de beaux films de sabre: Kamui no Ken (de Taro Rin) et Jubei Ninpucho (de Kawajiri Yoshiaki) sont de magnifiques long-métrages animés. A l'heure actuelle, les jeunes japonais se délectent des aventures animées d'un jeune ronin dans RurôniKenshin.
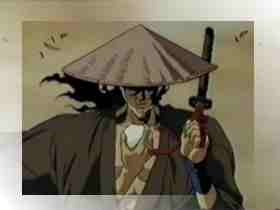
Le chef d'oeuvre de Kawajiri: Jubei Ninpucho (Ninja
Scroll)
J'ai un petit faible pour la scène finale du film de John Woo A Better Tomorrow 2: un protagoniste se fraye furieusement à l'aide d'un sabre japonais son chemin dans une immense demeure, éliminant de nombreux mafieux comme Goldorak élimine des soucoupes! Ce passage a également traumatisé Tony Scott et Quentin Tarantino, puisqu'on le retrouve diffusé sur une télévision durant une scène du film True Romance.
Ceci me permet de conclure en constatant que le chambara
a été assimilé par toute une génération de réalisateurs et de spectateurs
à des degrés plus ou moins importants. Il faut cependant garder en mémoire
que ce genre a une riche histoire et que son exploration permettra de sensibiliser
le spectateur occidental curieux sur le mode de pensée des japonais et sur
un passage de leur histoire : savoir lire entre les images de ces films peut-être
tout aussi enrichissant que l'exploration de volumineux ouvrages. A vous désormais
d'en tirer la substantifique moelle (et si vous n'avez toujours pas vu Les
sept samourais (quoi, des hérétiques?), précipitez-vous, il n'est pas encore
trop tard).
© viottip@hotmail.com
Bonne découverte...
Dans un film de sabre, on trouve...
Des geysers de sang...
Les personnages des chambaras et des films de ninja en dessins animés meurent
de façon très graphique: un véritable geyser de sang surgit de la plaie ouverte
par le sabre du héros.
La série de jeux vidéos sur Néo-Géo, Samourai Shodown vous permet même d'incarner
des sabreurs qui infligeront de telles blessures.
Métaphore sur l'âme et la vie qui quitte le corps du mourant, cette éruption
sangui-nolente est d'une puissance visuelle rare. Ce fut Kurosawa qui inventa
cet artifice en 1962 dans le film Sanjuro.

Le mercenaire Itto Ogami et son fils (Baby Cart)
Par la suite, il fut inévitable qu'au moins un adversaire trépasse
en déversant des litres de sang.
La série des Baby Cart (Kozure Ogami (Le
loup et l'enfant) adaptation d'un manga de Koike Kazuo) porta l'usage du
geyser à son apogée.
Cette série atteint des summums de violence, tous les adversaires meurent
en déversant d'impressionnants flots d'hémoglobine: mais le contexte et
le ton du film justifient cette violence qui reste essentiellement graphique
et ne doit surtout pas détourner le spectateur (adulte) de cette oeuvre
immanquable.

Zatoichi, le masseur aveugle qui manie la sabre à la perfection © Daiei
Dans un film de sabre on trouve...
La coupure en décalage...
Egalement incontournable, cette figure de style est
une véritable marque de fabrique des Ken-Geki.
Pour l'illustrer, la scène d'ouverture du troisième film de la série des Baby
Cart paraît exemplaire: Itto Ogami et son jeune fils sont dans une forêt de
bambous.
Le père s'enfonce un peu dans la forêt, laissant son fils à l'écart.
Il marche et soudain, sort son sabre, exécute des mouvements très rapides
avec son arme puis la rengaine. Rien ne se passe pendant deux ou trois secondes.
Tout à coup, trois bambous ont l'air de se couper tout seul: trois espions
ninjas accrochés en hauteur sur ces bambous tombent et succombent sous les
coups impitoyables du héros.
Cette autre trouvaille visuelle a été adoptée par de nombreux réalisateurs,
bluffant toujours le public. Le personnage Ray de l'école Nanto dans le manga
du duo Hara Tetsuo et Buronson découpe ses ennemis avec ses doigts. Ils tombent
découpés en tranches après que le héros leur ait déjà tourné le dos.
Dans le film Once Upon a Time in China II du Tsui Hark, le héros Wong Fei
Hung (Jet Li, acteur principal du récent Roméo must Die) frappe avec son bâton
les montants d'un immense échafaudage en bois puis recule. Son ennemi attend
que tout s'écroule. Mais rien ne se passe. Bien entendu, l'édifice s'effondre
au moment où l'adversaire de Jet li se précipite à sa rencontre.